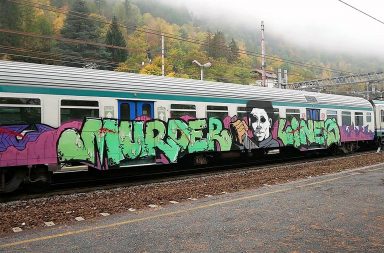Une enquête décapante sur les origines du writing, par Serouj Aprahamian
L’emprise de la mythologie dans le hip hop
Le rap aurait été inventé par les Dj disco de Brooklyn, le break proviendrait de la capoeira, une trêve de la guerre des gangs serait à l’origine de l’émergence d’une contre-culture; autant de fantasmes alimentés sans relâche par des personnes soucieuses de tirer profit d’un des aspects du hip hop. Ce qui est le pire, c’est le nombre incalculable de journalistes, d’universitaires, de documentaristes qui diffusent régulièrement de fausses informations sans aucune vérification. Un des exemples le plus flagrant est que l’origine du writing trouve son origine à Philadelphie et non à New York. Quel que soit l’ouvrage traitant de l’histoire du graffiti, Darryl ‘Cornbread’ Mc Cray est toujours présenté comme l’initiateur du mouvement, dans son quartier à la fin des années 60. En 1971, le Philadelphia Tribune déclare par erreur qu’il est mort, nouvelle à laquelle Cornbread répond en taguant son nom sur un éléphant du zoo de Philadelphie.
Parce que l’article sur le phénomène Cornbread parait quelques mois avant celui consacré à Taki183 dans le New York Times, pratiquement tous les livres, documentaires et articles ont propagé par la suite l’idée que le graffiti trouve son origine à Philadelphie. Si la documentation imprimée doit être le baromètre de l’origine du mouvement, pourquoi se contenter de consulter les archives du Philadelphia Tribune ? Pourquoi ne pas consulter Names, Graffiti and Culture, une étude de Herbert Kohl publiée dans l’édition d’avril 1969 de la revue Urban Review ?

Photos de tags par James Hinton, publiées dans l’étude de Kohl en 1967
Dans celle-ci, Kohl documente les graffitis des ados de Spanish Harlem marquant leur nom et leur numéro de rue sur les murs de leur quartier. L’auteur qualifie cela d’un phénomène complexe, manifestement différent du simple vandalisme, du graffiti des gangs ou des déclarations d’amour. Il a particulièrement interrogé le sens de l’identité et de la communauté qu’avaient ces ados en inscrivant leurs surnoms sur les murs. Fasciné par ce qu’il voit dans les rues de Harlem, l’auteur archive et produit un livre sur le sujet avec des photos prises par James Hinton. Toute les recherches effectuées par Kohl ont été réalisées en 1967, quatre ans avant la publication de l’article sur Cornbread.

Inscriptions sur les murs de Spanish Harlem en 1966. Photo : Don Hogan Charles
En outre, les jeunes dont il parle affirment que ce phénomène est apparu dans leur quartier au début des années 60. Effectivement, des photographies du Harlem espagnol datées de 1964 et de 1966, témoignent d’une organisation planifiée des alias accompagnés de numéros de rues inscrits sur les murs. Ce qu’a documenté Kohl correspond aux témoignages des premiers writers new-yorkais. Il est communément admis que Manhattan est le premier quartier à avoir été éclaté de tags, avec des zones spécifiques s’étalant de East Harlem à Washington Heights. Les observations de Kohl sont précisément liées aux témoignages des writers qui ont vécu l’émergence du mouvement.
Curieusement, le travail de Kohl est à peine mentionné dans les livres et les documentaires consacrés au writing. Quand c’est le cas, c’est toujours rapidement ou hors contexte. Par exemple, dans son dernier livre accompagnant le film Wall Writers, Roger Gastman reconnaît que l’étude de Kohl est le premier livre réel sur le graffiti, tout en tentant de minimiser son impact , en déclarant qu’il « rate le mouvement qui s’épanouit autour de cette pratique. »
Rien n’est moins vrai !

Tags stylisés à Spanish Harlem publiés dans l’étude de Herbert Kohl, 1967
Kohl décrit ce qu’il voit à New York à la fin des années 60 comme un phénomène culturel complexe, une « forme d’expression » récurrente , un véritable « art ». Il identifie les éléments essentiels du mouvement qui, l’année suivante, se répandront hors du quartier à Brooklyn et dans le Bronx. Il souligne spécifiquement que le writing n’était pas seulement «une manière de se montrer», mais plutôt une pratique culturelle socialement significative. À tel point qu’il sort de son rôle d’éducateur pour sensibiliser le public à ce sujet. Un historien du graffiti autoproclamé tel que Roger Gastman ne peut pas reconnaître qu’il a perpétué un mythe tout au long de sa carrière, affirmant dans son livre The History of American Graffiti que le « graffiti basé sur le nom » a été documenté pour la première fois à Philadelphie. Mais le fait qu’il essaie désormais de minimiser le travail de Kohl (tout en reconnaissant finalement son importance) n’aide pas du tout à comprendre ce mouvement.
Pour revenir au mythe de Cornbread, il existe d’autres problèmes. Il apparait que c’est un autre writer cité dans le Philadelphia Daily News, Tity et non Cornbread, qui aurait tagué un éléphant dans le zoo de Philadelphie. Pourquoi Cornbread aurait dû prouver qu’il était encore en vie alors que les journaux de Philadelphie se rétractent le jour d’après l’annonce de sa mort ? Une autre revendication étrange de Cornbread concerne le film Cornbread, Earl and Me qui s’inspirerait prétendument de sa vie alors qu’en réalité, il est basé sur un roman de 1966 de Ronald Fair, intitulé Hog Butcher.
Ce bilan de la désinformation ne serait pas préoccupant si les nombreux experts ne la répétaient pas régulièrement sans aucune vérification des faits. Face à cette information, certains affirment que peu importe où et comment le mouvement a commencé. Que nous ne devrions pas creuser si profondément dans le passé, mais, plutôt, regarder vers l’avenir.

Tags stylisés à Spanish Harlem publiés dans l’étude de Herbert Kohl, 1967
Si c’est le cas, pourquoi étudier l’histoire ?
Pourquoi ne pas laisser n’importe qui affirmer n’importe quoi sans aucune vérification possible ? Il est très important de connaitre les origines d’un phénomène aussi vaste que le writing. Si nous voulons vraiment le comprendre et ne pas prétendre qu’il est simplement tombé du ciel, il faut étudier son histoire. Apprécier cet art exige de comprendre sa lignée culturelle et le contexte social dans lequel il a effectivement émergé. Ainsi, c’est sans aucun doute à New York que tout a commencé.
L’historiographie du writing soulève un problème beaucoup plus important pour l’étude des expressions urbaines. La commercialisation rampante et les représentations inexactes d’une culture comme le hip hop sont le dernier symptôme d’un problème historique plus profond. Le Jazz et le Rock ont connu un schéma identique de désinformation et d’appropriation. C’est à la charge de ceux qui se soucient de la vérité et de la compréhension du hip hop, un mouvement culturel dominant, de trier entre faits et fiction. Plus de quarante ans après son émergence, il est temps d’appliquer des normes fondamentales de recherche, de vérification des faits et de regarder au-delà de ce que racontent les médias pour vraiment comprendre et apprécier ce mouvement. Il est important de documenter son passé et son présent de façon honnête et compétente. Et cela signifie inévitablement de mettre au rebut des années de mythologie établie.